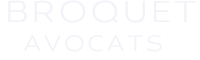La démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à son employeur sa décision de résilier son contrat de travail. Cette définition claire soulève cependant des litiges que la jurisprudence tente de régler.
Quelles sont les caractéristiques d’une démission
Une volonté claire et non équivoque du salarié
Les tribunaux considèrent généralement comme non valable une démission donnée de manière irréfléchie, sous le coup de la colère ou de l’émotion sur laquelle le salarié est revenu dès qu’il a retrouvé son calme. Il en a été jugé ainsi à propos d’une salariée qui avait déclaré, sous le coup de l’émotion : « Je préfère rester chez moi plutôt que de travailler dans ces conditions ». Dans un tel cas, les tribunaux admettent que l’intéressé revienne sur sa décision.
De même, lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur (non-paiement d’heures supplémentaires, par exemple), les juges peuvent considérer cette décision comme équivoque. Elle est alors requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les raisons de la rupture doivent être fondés et justifier cette décision. Aussi est-il conseillé, dans un tel cas, d’énoncer les faits reprochés à l’employeur dans sa lettre de démission afin de faciliter la preuve en cas de contestation ultérieure.
Ainsi, elle ne peut en aucun cas être implicite. L’employeur ne peut se baser sur le comportement de son salarié pour le considérer comme démissionnaire.
Un consentement libre
Les tribunaux considèrent que la démission n’est pas librement consentie lorsque le salarié n’a pas les capacités intellectuelles ou linguistiques pour mesurer la portée de son acte.
Il en est de même lorsqu’elle a été donnée sous la pression ou la menace de l’employeur. Tel est le cas lorsque l’employeur qui souhaite se débarrasser d’un salarié lui rend la vie impossible pour l’amener à démissionner ou encore s’il le force en usant de moyens déloyaux (chantage, violence…). Ainsi est-elle considérée comme extorquée quand elle est obtenue :
- sous la menace de poursuites pénales ;
- sous la menace d’un licenciement pour faute lourde.
Dans ce cas de figure, il y a requalification en licenciement sans cause réelle est sérieuse.
Forme à observer
Alors que la loi fait obligation à l’employeur de motiver les licenciements et de les notifier par lettre recommandée avec accusé de réception, ces conditions ne s’imposent pas en matière de démission.
Un salarié peut donc démissionner verbalement, même par téléphone, dès lors que ceci résulte d’une manifestation non équivoque et qu’il n’est pas tenu d’en indiquer le motif.
Pour éviter toute contestation, il est néanmoins conseillé que le salarié la présente par écrit et l’expédie par courrier recommandé avec accusé de réception à son employeur. Les tribunaux considèrent toutefois que si elle est envoyée au supérieur hiérarchique, elle reste valable.
Conséquences de la démission
La démission entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail et ne nécessite pas l’accord de l’employeur. C’est en effet cette date qui fixe le point de départ du préavis lorsque celui-ci est prévu.
Sans écrit, c’est au salarié qui soutient avoir démissionné d’en faire la preuve et de justifier de la date exacte.
Inversement, si l’employeur prétend que son salarié a démissionné, il doit lui aussi le prouver.
Dans un cas comme dans l’autre, la preuve fait par tous moyens : témoignages, présomptions…
La démission abusive
La loi prévoit que le salarié peut être condamné à verser des dommages-intérêts en cas de démission abusive. C’est notamment ce qui a été jugé dans le cas d’un salarié qui a brusquement cessé son travail en dénigrant son employeur et en passant au service d’un concurrent.
Mais le simple fait de démissionner pour exercer une activité concurrente, sans intention malveillante, ne constitue pas, en soi, une démission abusive.
La preuve incombe en tout état de cause à l’employeur.
Elle peut par contre être abusive si une clause du contrat de travail interdit la démission avant une date précise, sous peine du versement d’une indemnité. Le cas s’est produit pour un employeur qui, ayant assuré la formation du salarié, lui avait interdit de démissionner avant une certaine date, sous peine de rembourser les frais de formation. La Cour de cassation juge licite ces clauses dites de « dédit-formation » .
Lorsqu’un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail conclut un nouveau contrat de travail, lé nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’ancien employeur s’il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans la rupture.